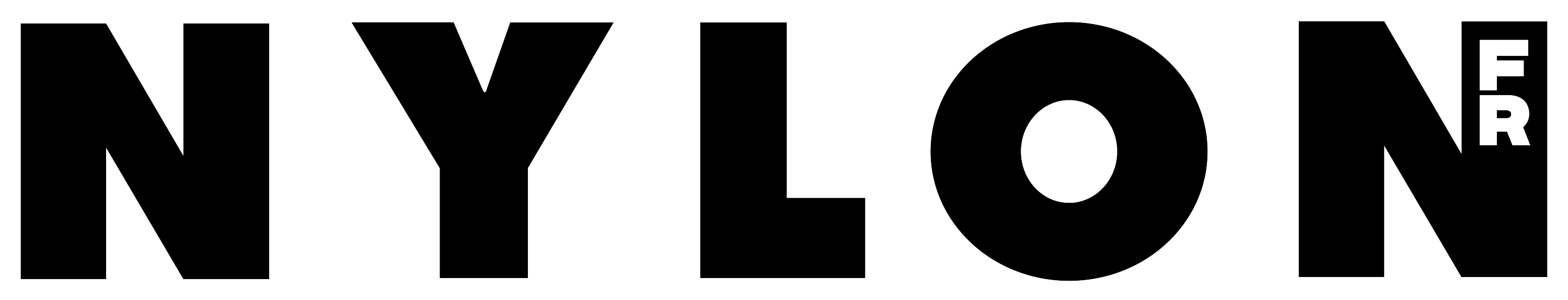Il y a des concerts qui ressemblent à des chapitres, d’autres à des lettres d’amour. Et puis il y a ceux qui ressemblent à des confessions, celles qu’on attend depuis des années sans oser le formuler. La première date parisienne de Lady Gaga à l’Accor Arena appartient à cette catégorie-là. On entre dans la salle comme on entre dans une cathédrale gothique : le cœur prêt à recevoir quelque chose qui dépasse le spectacle, quelque chose qui ressemblerait presque à une vérité.
Sur un grand écran, une plume trace des mots sur un papyrus, comme si Gaga écrivait l’histoire avant même qu’elle ne commence. Tout devient soudain solennel : Bizet, Berlioz, la sensation étrange qu’on s’apprête à vivre un opéra pop. Et puis l’image change, un discours entre deux Gaga se crée, ensuite un cri jaillit du public. Comme si Paris disait : ça y est, elle est là.

Elle surgit en Mistress of Mayhem, perruque noire, robe rouge qui cache alors la totalité de ses danseur.euse.s. Et avant même de réfléchir, on comprend que cette Gaga-là n’est pas une incarnation de plus : c’est une version d’elle qu’on n’avait pas encore rencontrée. “Bloody Mary” ouvre le bal, et soudain tout s’aligne. La dramaturgie, la silhouette, la voix. Puis l’enchaînement : “Abracadabra”, “Judas”, “Aura”, “Scheiße”, “Garden of Eden”. C’est sombre, précis, presque trop généreux pour un début de show. Comme si elle disait : je vous dois ça. Et plus encore. Ce concert la n’est clairement pas un best-of de ses plus grand succès, elle nous offre une histoire.
Et puis la scène bascule. Une autre Gaga apparaît : blonde, presque fantomatique, un écho à ses débuts. Deux Gagas, deux temporalités, deux façons d’avoir survécu au succès. Elles jouent une partie d’échecs sur “Poker Face”, mais ce qu’on voit, c’est bien plus qu’un duel : c’est une conversation entre l’innocence et la douleur, entre l’ambition et sa facture. Quand la Mistress prononce « qu’on lui coupe la tête », quelque chose serre la salle entière. On ne sait pas si on regarde une métaphore ou une confession. Probablement les deux.

La suite appartient à un rêve gothique dans lequel on tomberait sans s’en apercevoir. Blonde Gaga réapparaît perdue, entourée de squelettes, presque fragile. Elle revisite “Paparazzi” en béquilles — un geste qui n’est pas un gimmick mais une mémoire physique. Son corps se souvient avant elle. Et plus elle avance dans ce rêve, plus on sent qu’elle hésite à en sortir, elle le crie alors à la Mistress Of Mayhem. Comme si ce monde irréel lui permettait enfin de respirer.

Les tableaux défilent avec une intensité qui laisse peu d’espace à la pensée. Mayhem s’emboîte parfaitement à ses classiques, à tel point qu’on a l’impression de redécouvrir les nouveaux morceaux. Elle nous offre “Alejandro”, “Summerboy”, “Applause”, comme des lettres retrouvées au fond d’une boîte qu’on pensait perdue.
Puis vient son moment au piano. Chez elle, ce moment n’est jamais décoratif. C’est une parole déposée sans costume. Elle parle de ses vingt ans de carrière, de réinvention, de public qui change mais aussi de celui qui reste. Et soudain, comme un énième cadeau à chérir, elle joue “The Edge of Glory”. On a tous un souvenir attaché à cette chanson. Ce soir-là, ils réapparaissent tous à la fois, comme si quelqu’un rallumait en nous une pièce qu’on n’avait pas visitée depuis longtemps. Quand elle dit : « If you ever need me, just listen to the song, I’ll be right there », on entend un vœu plus qu’une phrase.

If you ever need me, just listen to the song, I’ll be right there
Elle quitte alors la scène comme si elle avait encore trop d’amour à donner pour rester à sa place. En interprétant “Vanish Into You”, elle signe des vinyles, des t-shirts, des CD,… Elle effleure des mains, des épaules, des regards, non pas pour “faire proche”, mais parce qu’elle ne sait pas aimer autrement. À cet instant, on comprend qu’elle veut offrir plus qu’un live : elle veut offrir un morceau d’elle.
Le final est un uppercut émotionnel. Elle réapparaît en créature aux doigts interminables, prête à ressusciter “Bad Romance” comme si c’était la dernière fois. On croit que tout s’arrête là. C’est la fin.

Mais non. Sur l’écran, on la retrouve, sans perruque, sans maquillage. Une Gaga vraiment mise à nue. Elle commence “How Bad Do U Want Me” et traverse les coulisses pour nous rejoindre une dernière fois. Quand elle arrive sur scène, le public lui offre un cadeau en retour, des pancartes : We want you for real. Et elle craque. On craque avec elle. Ce moment-là — veste noire, lumière blanche, simplicité totale — : c’est la capacité de devenir immense dans le minimalisme. Elle fait monter toute son équipe, remercie chaque personne, transforme la scène en coulisses, les coulisses en scène. Un dernier souffle. Un dernier applause. Un dernier geste d’amour….
On quitte la salle avec cette sensation étrange qu’elle nous a donné quelque chose qu’elle n’avait plus offert depuis longtemps : elle-même. Pas la star. Pas l’icône. Pas la créature. Lady Gaga.